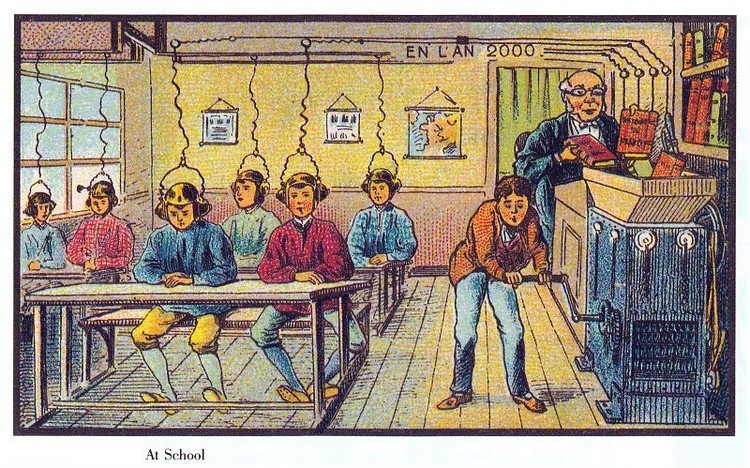Je recense ici des ressources consultées ou découvertes en 2018.
- Inconsistance et dangers du culte des différences en pédagogie
- L’éducation, les sciences du cerveau, la sociologie
- En 2019, une autre éducation aux médias est possible
- Que signifie éduquer au numérique ? Pour une approche interdisciplinaire
- Le problème du relativisme dans l’enseignement de la philosophie