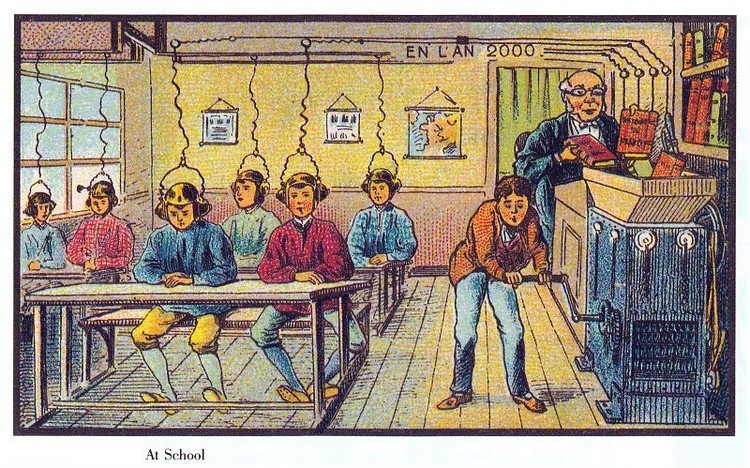Je recense ici des ressources consultées ou découvertes en 2015.
Éduquer aux médias ou imposer la vérité officielle ?
L’EMI, une « bonne nouvelle » pour les professeurs documentalistes ?
En 2014, j’ai écrit « Faut-il imposer le numérique en éducation », ainsi que « Sur la réflexivité dans les pratiques d’éducation aux médias et à l’information » (Mediadoc, 2014).
Il y a des enjeux à penser les différentes mutations et évolutions des sociétés contemporaines : médias et technologies (numériques ou non), interculturalité, valeurs (citoyenneté, démocratie, etc.), langages, etc. (quelle que soit la forme que prennent les dispositifs visant à y éduquer, bien que le débat soit aussi très important).
De plus, je pense que les compétences info-documentaires sont effectivement une excellente base pour réfléchir à une « éducation à l’information » (j’ai d’ailleurs coécrit un article avec Akémi Roberfroid, intitulé « Journaliste et documentaliste : quelle complémentarité ? »). Une éducation à l’info-doc qui ne serait qu’une éducation aux usages de la presse me semblerait sérieusement lacunaire, par exemple.
Cependant, je rejoins Pascal Duplessis dans plusieurs de ses inquiétudes et réserves quand celui-ci pointe des repères flous, parfois fourre-tout, accompagnés d’effets de mode pédagogiques (et politico-institutionnels, témoignant parfois de conflits territoriaux entre les acteurs de terrain, revendiquant tous leur part du gâteau). Surtout dans la mesure où il invite à prendre du recul. Déjà en 2012, j’attirais l’attention sur « Les apprentis sorciers de l’éducation aux médias » qui s’engouffrent dans des pratiques hasardeuses, inefficaces ou encore marquées d’un parti pris flagrant à l’égard des technologies et leurs usages.
En effet, si l’éducation aux médias (et à l’information) consiste à remplacer les idées reçues des apprenants par celles des enseignants ou du pouvoir en place, selon moi elle passe tout-à-fait à côté de ses enjeux. Mais bon, quand une Ministre laisse entendre qu’elle va allouer des budgets (ce n’est pas tous les jours, il faut le reconnaitre), l’occasion est trop belle, sans doute…
A ce niveau, je crois néanmoins que les professeurs documentalistes, dont le statut relativement hybride occasionne des difficultés de terrain, notamment au niveau de la reconnaissance institutionnelle, sont loin d’être les premiers concernés.
> Lire une réponse des auteures de l’article auquel Pascal Duplessis a entendu réagir
Albert Jacquard – L’intelligence
Une vision de l’intelligence constructiviste et existentialiste, étude de cas intéressante dans le cadre du cours de Philosophie et éthique de la communication.
Faut-il interdire le smartphone à l’école ?
Les deux études citées dans l’article :
- http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1350.pdf
- http://advertising.microsoft.com/en/cl/31966/how-does-digital-affect-canadian-attention-spans
Site de Philippe Meirieu : Cours de philosophie de l’éducation
Les textes d’illustration présentés ici peuvent être complétés opportunément par les textes présentés dans le chapitre « Textes du patrimoine pédagogique ».
Plusieurs chapitres recoupent, nuancent ou prolongent des éléments que j’aborde dans mon cours sur les enjeux philosophiques (épistémologiques et éthiques) des médias et de l’éducation aux médias (anciennement intitulé « Cours de philosophie et éthique de la communication »).
« Les éducations à » : Actes du Colloque International de Rouen
Certaines interventions de ce colloque fournissent également des réponses et approfondissements – parfois explicitement – à un article d’Alain Beitone que j’avais recensé ici.
Metacognition: Nurturing Self-Awareness in the Classroom
« L’efficacité et l’équité des systèmes éducatifs sous l’angle du curriculum prescrit dans une approche par compétence »
Recherches en éducation – Des élèves et des savoirs à l’ère numérique : regards croisés
Entre fascination et rigueur scientifique : les dérives des neurosciences | Canadian Education Association (CEA)
Robots are hurting middle class workers, and education won’t solve the problem, Larry Summers says
Métacognition et réussite des élèves – Les Cahiers pédagogiques
L’enseignement ou la nouvelle Nef des fous… Quelle galère !
Voir aussi l’article cité : « Dangers, incertitudes et incomplétude de la logique de la compétence en éducation ».
Article intéressant sur plusieurs points.
Sujet tellement vaste et complexe, que je traite en partie dans plusieurs articles de ce site.
… Et à la fois que je contrebalance en utilisant le vocabulaire des compétences et les arguments didactiques sur lesquels « l’approche » (pour peu qu’il n’y en ait qu’une) peut se reposer, notamment dans Les apprentis sorciers de l’éducation aux médias ou encore dans Enjeux philosophiques des médias et de l’éducation aux médias.
En très – trop – bref et caricatural (par rapport à cet article qui mérite mieux) :
- Sur le risque de marchandisation croissante de l’école, j’adhère.
- Sur l’absence de fondements logiques, scientifiques ou empiriques en-dehors du monde entrepreneurial, je suis moins d’accord.
- Sur le fait de considérer qu’il n’y a qu’une seule approche uniforme des compétences – grosso modo, les pédagogies dites « actives », « par projets », etc., et ce au détriment de « savoirs » -, je suis assez en désaccord, même si ce sont celles qui semblent implicitement le plus mises en avant. On peut opter pour une pluralité de contenus et de méthodes tout en s’inscrivant dans certaines logiques sous-jacentes des approches par compétences.