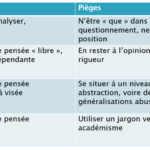Cet article mêle volontairement des questions éthiques et épistémologiques, qui sont débattues longuement dans d’autres topics de ce site. Il s’agit d’un point de vue global qui présente une démarche d’esprit qui oscille entre la critique, le doute et la (re)construction. Il introduit les pôles de questionnement éthique et épistémologique.

Le cheminement réflexif exposé ici est inspiré principalement de philosophes comme F. Hegel, R. Descartes, H. Putnam, ou encore de pragmatistes comme W. James et J. Dewey.
Des développements plus spécifiques à l’éthique se trouvent dans les articles suivants : une philosophie de la finitude, l’homme, un être inhumain ? et points de vue sur l’homme.
Commençons par le doute, radical
Le vrai, le beau et le bien sont peut-être relatifs. En effet, on peut remettre en cause la logique et la science par l’hypothèse que nous vivons dans un monde absurde et illusoire (qu’il existe un malin génie divin (Descartes) dont le but serait de nous tromper, par exemple), que nous sommes des cerveaux dans une cuve (expérience de pensée de Putnam), manipulés par la technologie (on peut voir ce genre de pensées illustrées dans le film Matrix, par exemple, ou encore imaginer que nous évoluons dans un jeu de simulation de vie comme Les Sim’s). Peut-être le monde est-il tout simplement absurde ou nous est « caché », et que nous nous leurrons avec nos perceptions.

Les choses physiques (comme une pierre, un arbre), le « réel ». Tout cela existe-t-il vraiment ? On peut remettre en cause le monde sensible assez facilement. Nos sens nous trompent parfois (plonger un bâton dans l’eau semble le déformer), pourquoi ne nous tromperaient-ils pas toujours, se demandait Descartes dans le Discours de la méthode. Platon imaginait que le sensible, le palpable, n’est que tromperie, ou du moins pâle copie du véritable « réel » que sont les Idées, un monde « à part », immatériel. Kant, quant à lui, ouvre la voie des penseurs constructivistes, en soulignant que nous ne percevons jamais la réalité en tant que telle (noumènes), mais toujours une représentation de celle-ci par le filtre de notre raison.
En épistémologie, discipline philosophique qui traite de la connaissance, on n’hésite pas à questionner la science et les mathématiques de manière radicale, remettant en cause la prétention scientiste d’accéder à une vérité totale, universelle et purement objective à travers les sciences (cf. notamment Popper, Kuhn, Lakatos), tout en délimitant en réalité leur(s) domaine(s) respectif(s).
On est autorisé à se poser d’autres questions : y a-t-il vraiment de l’ordre dans le monde ? Si oui, peut-on le percevoir ? L’homme et la pensée ne sont-ils pas de simples réactions entre des amas d’atomes qui constituent tout étant jusqu’à présent connu ? Ce sont des exemples de remises en doute radicales que l’on peut opérer en philosophie. C’est cette première attitude de remise en question, de réflexion profonde, parfois poussée à l’extrême, que cet article veut mettre en évidence.

Toutes ces questions remettent en cause des postulats de base de nos réflexions habituelles. On ne doute jamais -ou très rarement- du fait que 2+2=4 (or 2+2=5 dans le roman 1984 d’Orwell). Pourtant, cela part du principe que nous vivons dans un monde ordonné, que la raison peut saisir cet ordre, et de surcroit le comprendre par l’intermédiaire de conventions (au sujet du rapport entre les conventions et la vérité, cf. la querelle des universaux).
Nous n’avons aucune preuve indubitable / incontestable que le monde est ordonné, pas plus de preuves que pour l’existence de Dieu. Nous n’avons aucune preuve qui ne puisse être discutée que nous existons, ni que nous pensons. Nous n’avons non plus aucune preuve évidente que le vrai, le beau et le bien existent. Ce qui n’est pas évident pour une personne n’est pas évident dans l’absolu. Quand bien même ils existeraient, il n’est même pas incontestable qu’il faut les poursuivre, ni même d’ailleurs que l’on y a accès. Si ça se trouve, l’homme est prédestiné à faire le mal, à s’autodétruire. Peut-être d’ailleurs que c’est vraiment cela, le bien (question de convention ?). Peut-être ne sommes-nous que des pantins dans la fiction d’une intelligence supérieure, et que le monde est absurde, comme celui développé par Lewis Carroll.
En éthique (discipline philosophique qui traite de l’action humaine) également, on peut remettre de nombreuses choses en cause : l’être humain semble capable des pires atrocités. Il peut torturer en souriant, ou en s’en fichant, simplement. Il peut prendre plaisir à voir souffrir un animal, il peut ne pas se soucier des dégâts qu’il cause à la planète et à la nature. Parfois, je me dis que lorsqu’une violence est vaincue, elle est remplacée par une autre, elle prend une autre forme. Avant, on utilisait ses poings et maintenant, on utilise sa place haute dans la hiérarchie, on use de coercition, de chantage, on oppresse. Avant, on se criait dessus, maintenant, on humilie, on harcèle, on casse psychologiquement. N’est-ce pas tout aussi grave ? L’humain tue, torture, fait souffrir. Mais le pire, c’est qu’il peut le faire en s’en fichant, voire en s’amusant.
En somme, on peut douter de tout, même de la capacité de l’homme à faire le bien, même de sa capacité à connaître, et même encore de son existence.
> NB : notre article est bien à considérer comme une introduction à des problématiques philosophiques (épistémologiques et morales). Il mêle de nombreuses dimensions qu’il serait plus rigoureux d’aborder séparément. En guise de prolongement par rapport au scepticisme, lire par exemple : Le scepticisme du XVIIe au XIXe siècle
Mais on peut s’engager
La solution consiste en un acte de croyance, sinon on est dans une impasse pragmatiste, c’est-à-dire que l’on ne peut pas poser de choix. Si on doute de la logique, alors on ne peut agir qu’en supposant le chaos et donc, en rejetant tout des sciences, des lois, etc.
Le relativisme (sous sa forme radicale, consistant à croire que tout se vaut, qu’il n’existe pas de vérité) empêche l’action, la paralyse, ou au contraire en enlève toutes les bornes, et mène alors effectivement au chaos. Nous avons tout intérêt à explorer toutes les solutions possibles, à envisager tous les arguments, à envisager tous les lieux où nous pouvons nous tromper. Mais à un moment, nous devons choisir, croire, nous engager. La voie d’un relativisme radical et irréfléchi (« tout se vaut ») n’est pas suffisante[1], même s’il faut savoir douter (pour ne pas tomber d’ailleurs dans le dogmatisme).
L’engagement, le choix de croire (faire confiance), c’est le second mouvement de la réflexion philosophique : c’est Descartes qui retrouve le cogito, c’est Platon qui affirme la beauté des Idées, c’est Popper qui affirme un critère de scientificité des théories scientifiques ou Russell qui engendre la théorie des types logiques, etc.
Nous avons un intérêt pratique, éthique, à « faire comme si » le monde était ordonné, « faire comme si » l’homme pouvait agir pour plus de bien, de tolérance, de bonheur, à « faire comme si ». Ce n’est pas faire semblant de croire, mais plutôt faire un pari, prendre position dans le monde. C’est un acte de confiance.
> [Mise à jour 2024] Lire aussi : HUNYADI, M., La confiance est le lien social le plus élémentaire, Philosophie Magazine, 2020.

Car l’enjeu est de taille[2]. A un moment, nous choisissons de croire, nous engager. Cet engagement peut se faire inconsciemment, sous couvert d’incontestabilité, ou au contraire être assumé comme tel. Il est intéressant de savoir douter (pour ne pas tomber d’ailleurs dans le dogmatisme), mais la voie du relativisme est une impasse : il faut savoir garder à l’esprit qu’il n’y a pas d’évidence universelle, et rester humble par rapport à sa façon de voir les choses. Nous procédons par engagements, non par certitudes indiscutables ; par croyances, non par vérités indubitables.
En d’autres termes, il ne faut pas oublier qu’au quotidien, nous « faisons comme si ». Certaines chosent vont de soi pour nous, seulement parce que nous attestons d’un engagement chaque jour, via nos actes.
Quelques postures (parmi d’autres) me paraissent profitables en ce sens :
- être au clair avec ses engagements : on peut douter de tout, mais chaque positionnement est un engagement, qui fait en corollaire que l’on croit en certaines choses, à moins de se situer dans une posture auto-contradictoire. Ces axiomes ou postulats gagnent à être précisés. Il n’y a rien de pire qu’un engagement qui s’ignore, or, au fond, tout est basé sur des engagements, des actes de confiance, puisque les fondements profonds de nos « connaissances » peuvent être remis en doute.
- argumenter et écouter, faire droit à la complexité (pour une éthique coopérative de la discussion, cf. Grice, Eco). Savoir écouter, c’est savoir se remettre en doute (comprendre les fondements et enjeux d’une position différente), même sur ses bases les plus profondément ancrées, tandis qu’argumenter, c’est savoir se repositionner et se réengager en fonction des nouvelles perspectives, en donnant les raisons de son engagement. Il faut savoir faire la part des choses ; un point de vue similaire se retrouve déjà chez des penseurs comme Aristote (si vous me permettez l’analogie avec l’idée de « juste milieu ») ou Hegel avec l’idée de la dialectique de la pensée, qui s’enrichit de son contraire. On évite donc à la fois le dogmatisme, la fermeture d’esprit et le relativisme du « tout se vaut », sorte de pseudo-pensée hypocrite. Face à la complexité du monde, il est intéressant de multiplier les regards, postulats, paradigmes…
- postuler qu’un bien (ou un mieux) est possible (et donc croire en ce dernier) notamment par les sciences (la connaissance), par l’éthique (l’agir humain)… Croire que le bien existe et qu’on peut arriver à plus de bien résulte d’un engagement initial. Cela ne va pas de soi, néanmoins, à quoi bon s’engager si ce n’est pas dans l’espoir d’un mieux (pour soi, pour les autres, voire pour tous) ? C’est la question du sens.
- croire en l’humain et dans le fait qu’il est capable de construire un monde meilleur (tant du point de vue épistémologique – la connaissance – que du point de vue moral, et pourquoi pas à travers l’art, la justice, etc.), et s’engager également pour trouver comment y arriver. L’être humain est complexe et son comportement fait parfois douter de « l’humanité ». Il n’est pas démontrable que l’homme soit capable d’arriver à plus de bien, plus d’humanité. Cependant, cette prise de position nous encourage à tenter de réaliser cet idéal. En vain, peut-être, mais si l’on ne tente pas… ?
D’autres axiomes, davantage relatifs à la question de la connaissance valide, se trouvent notamment chez Monvoisin (2007, p. 78) :
« Pour résumer, si on veut commencer une entreprise intellectuelle de description vraisemblable du réel, il nous faut trois axiomes :
– postuler ma propre existence.
– postuler une réalité en dehors de moi, qui ne soit pas ma projection.
– postuler que mon esprit soit capable de dire des choses plus vraies que d’autres sur cette réalité.
Ces trois axiomes sont improuvables, mais sans eux, il n’est plus possible de soutenir que quoi que ce soit soit vrai ou faux ».
Selon moi, toute pensée, surtout humaine, sociale, philosophique, se situe dans un mouvement d’aller-retour (plus précisément, je fais allusion ici particulièrement à Hegel, mais plus globalement à toute la philosophie qui s’efforce d’articuler liberté et responsabilité, croyance et critique, doute et engagement). La pensée s’enrichit de la critique, elle est mouvante, elle avance. Liberté et déterminisme ne s’opposent pas, mais se complètent, et c’est pareil avec certaines idées traditionnellement opposées en politique, par exemple. Souvent, il est plus intéressant de voir comment concilier les points de vue que de trancher entre eux. Ainsi, éviter dogmatisme et relativisme, éviter de penser en oppositions, mais bien penser en évolution, en processus, en ouverture, en enrichissement mutuel.
C’est à mes yeux le véritable enjeu de ce blog, ainsi que de la philosophie. Il faut prendre des positions, parfois fermes, tout en gardant à l’esprit qu’elles peuvent être enrichies de la critique. Je développe davantage une approche mêlant éthique et épistémologie (relative aux attitudes propices par rapport à la recherche de la vérité) dans les articles suivants :
- Est-ce que « la Terre est ronde » est une affirmation métaphysique ?
- Question de points de vue
- L’objectivité et la neutralité sont-elles possibles ?
- Hegel – la pensée s’enrichit de la critique
- Pour une éthique de la discussion
- « Tout est vrai, dans une certaine mesure »
Voyez celui-ci comme une porte d’entrée à cette réflexion qui lie éthique et épistémologie.
NB : voir aussi l’excellent article (en anglais) Misconceptions about science (malentendus à propos de la science).
[1] Le relativisme est une position auto-contradictoire. Si « toutes les positions se valent », alors les deux positions consistant à dire (1) que « toutes les positions se valent » et (2) « il y a des positions qui ont plus de valeur que d’autres » se valent, ce qui est une contradiction.
De plus, prétendre ne jamais s’engager, ne jamais juger, ne jamais « trancher » ou choisir est un faux-semblant qu’il est impossible de réellement tenir ; il s’agit d’une apparence, d’un leurre que des personnes se fixent elles-mêmes. Le relativisme extrême est intenable pragmatiquement (nous agissons toujours selon l’idée que certaines choses sont plus vraies que d’autres, lorsque l’on utilise une technologie par exemple : on présuppose que « ça fonctionne », et on tient donc cela pour plus vraisemblable que l’hypothèse d’un monde tout à fait chaotique et imprévisible).
Cette position implique une attitude de fermeture à la remise en question (« puisque « chacun sa vérité », tu as ta vérité et moi la mienne »)
Élargi à sa formule « il n’y a pas de vérité » (scepticisme, nihilisme), il se présente en réalité comme la seule vérité digne de ce nom (« j’estime vrai qu’il n’y a pas de vérité »). Non seulement il est contradictoire, mais il rejoint qui plus est le dogmatisme (idée qu’il n’y a qu’une seule vérité, qu’un seul principe supérieur à partir duquel on juge). Cette critique s’applique très bien au quotidien à ceux qui prétendent rejeter en bloc tous les dogmes : ne se fondent-ils pas eux-mêmes dans un moule ?
Enfin, caricaturées, les propositions telles que « à chacun sa vérité », « il n’y a pas de vérité », « toutes les croyances se valent », etc. sous-entendraient par exemple que « exterminer les juifs » ou « violer et torturer des enfants » et « vivre pacifiquement ensemble » ou « respecter son prochain » sont des vérités/croyances équivalentes.
[2] William James (cf. aussi Dewey ou Peirce, dans la même lignée de philosophes pragmatistes) est une des personnes que je cite pour relier la question de la croyance et la question de l’éthique. Il est question de rejeter tout relativisme « primaire », tout en rappelant que nous fonctionnons par des croyances. Il fait partie des penseurs qui défendent une sorte d’engagement en épistémologie : « est vrai ce qui a des enjeux à être désigné vrai ». Il y a des choses qu’on ne peut prouver, mais si on les considère comme vraies, cela ouvre des portes phénoménales à la pensée. (Par exemple, l’existence de l’inconscient, la théorie de l’évolution… sont des choses qui permettent une fertilité scientifique, une fertilité du questionnement et des créations, si on les considère comme vraies). Cela vaut, à mon avis aussi, pour l’argumentation : on peut attribuer un poids plus grand à certaines croyances en fonctions des enjeux qu’elles véhiculent.
On pourrait en outre citer Kant, principalement pour sa rigueur formelle et le passage de sa métaphysique à son éthique : le sens se retrouve pour moi dans le niveau éthique, dans la question des attitudes, de l’agir, car au fond, le choix (libre ?) de croire et de s’ouvrir sont aussi des actes, des comportements humains.